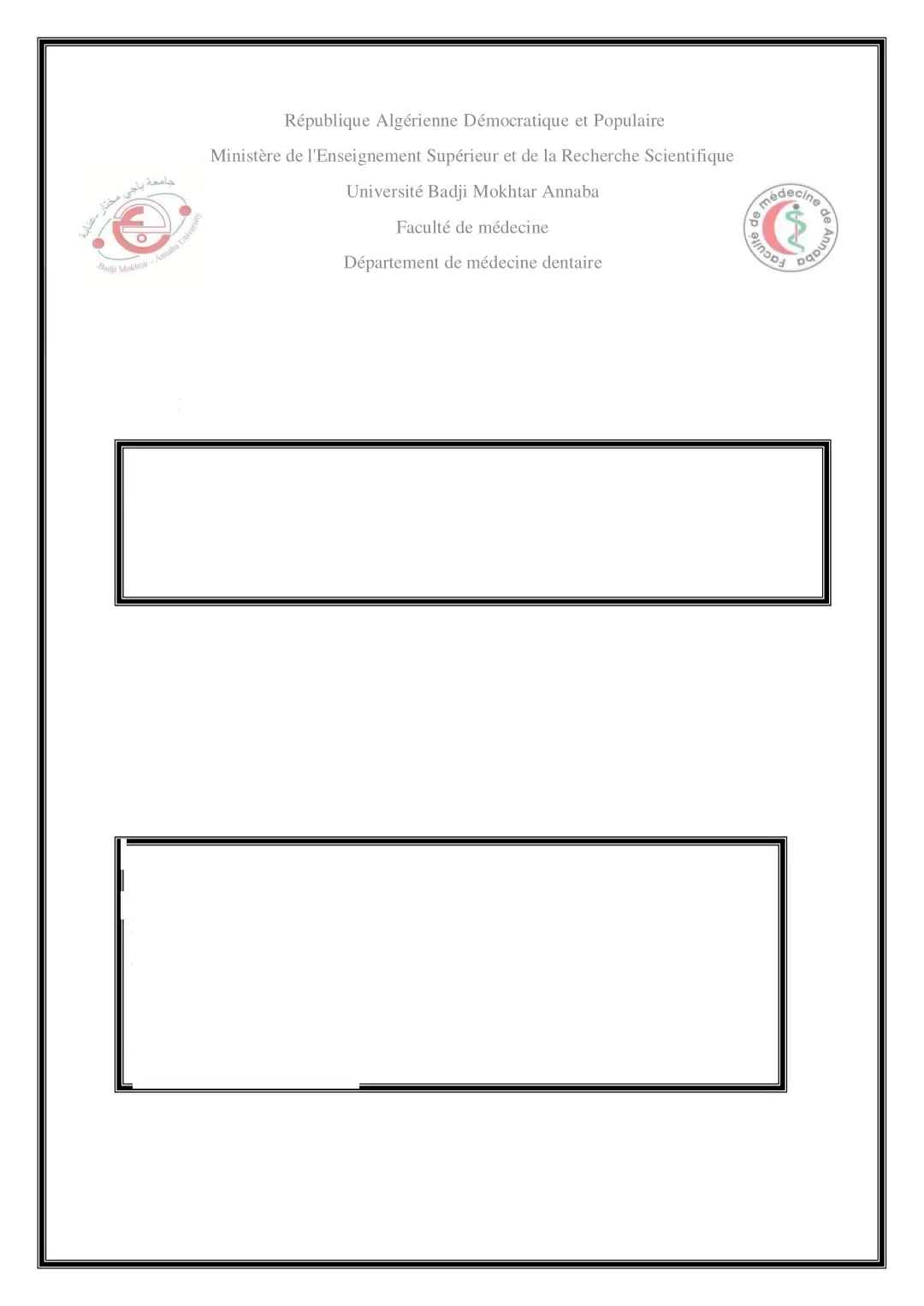Scene 1 (0s)
[Virtual Presenter] L’ODONTOPHOBIE CHEZ L’ENFANT : STRATEGIE ET PRISE EN CHARGE Membres du jury : Président : Dr. LAHIOUEL Assesseurs : Dr.LAYACHI Dr.HADJ MOUSSA Dr.HAMOUDA Encadreur : Pr. A.CHERIFI Dr.DERBALI République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Badji Mokhtar Annaba Faculté de médecine Département de médecine dentaire MEMOIRE DE FIN D'ETUDE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE DENTAIRE Présenté publiquement par : • ZEDIRA Faikelnadhir • KEHAILI Abdelhakim • KADJOUF Abdelhak Année universitaire 2022-2023.
Scene 2 (1m 18s)
[Audio] A Pr. CHERIFI Professeur en médecine dentaire Dr. DERBALI Pour voir accepté de nous encadrer et de nous avoir fait confiance en nous confiant un thème d'actualité plus que passionnant. Pour votre soutien infaillible à chaque étape de la réalisation de ce mémoire, pour votre gentillesse et la qualité de vos enseignements durant ces années d'études, votre compétence, votre dynamisme et votre rigueur ont suscité une grande admiration et un profond respect. Vos qualités professionnelles et humaines nous servent d'exemple. Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance et de nos respectueux remerciements. REMERCIEMENTS.
Scene 3 (2m 7s)
[Audio] A notre président de jury de mémoire, Dr. LAHIOUEL Vous nous avez fait un grand honneur en acceptant la présidence de ce jury. Nous remercions pour votre enseignement et nous vous sommes très reconnaissants de bien vouloir porter intérêt à ce travail. Nous avons bénéficié, au cours de nos études, de votre enseignement clair et précis. Vos qualités humaines, votre générosité n'ont rien d'égale que votre compétence. Veuillez trouver ici, professeur, l'expression de nos sincères remerciements. REMERCIEMENTS.
Scene 4 (2m 51s)
[Audio] A notre juge, Dr. LAYACHI Vous nous avez fait, avec gentillesse l'honneur d'accepter la codirection de cette thèse. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de corriger cette thèse malgré vos nombreuses occupations. Nous vous remercions également pour tous les travaux pratiques passés à vos côtés ; nos bases fondamentales y ont été grandement renforcées. Veuillez trouver ici l'expression de nos vifs remerciements et de notre profond respect. REMERCIEMENTS.
Scene 5 (3m 29s)
[Audio] A notre juge, Dr. HADJ MOUSSA Nous vous remercions d'avoir accepté de participer à ce jury. Nous vous sommes reconnaissantes de la disponibilité dont vous avez preuve en vers nous tout au long de nous études. Nous vous remercions pour partager avec nous vos expériences dont nous nous souvenons toujours lors de nos travaux cliniques. Veuillez trouver ici l'expression de notre sincère gratitude et de notre profond respect. REMERCIEMENTS.
Scene 6 (4m 4s)
[Audio] A notre juge, Dr. HAMOUDA Nous vous remercions d'avoir accepté de participer à ce jury. Nous vous sommes reconnaissantes de la disponibilité dont vous avez preuve en vers nous tout au long de nous études. Nous vous remercions pour partager avec nous vos expériences dont nous nous souvenons toujours lors de nos travaux cliniques. Veuillez trouver ici l'expression de notre sincère gratitude et de notre profond respect. REMERCIEMENTS.
Scene 7 (4m 38s)
[Audio] EL HAMDOULILAH De m'avoir donné la capacité d'écrire et de réfléchir, la force d'y croire, la patience d'aller jusqu'au bout du rêve. Je dédie ce modeste travail : Nos chers parents, vous nous avez donné le courage pour réussir. Tout ce qu'on peut d'offrir ne pourra exprimer l'amour et la reconnaissance que nous vous porte en témoignage, nous vous offrons ce modeste travail pour vous remercier vos sacrifices. Aucune dédicace ne saurait exprimer nos sentiments que dieu vous préserve et vous procure santé et langue vie. A nos sœurs et nos frères à qui nous souhaitons tout le bonheur. A nos amis, nos collègues on les souhaite une bonne continuation. Nos reconnaissances vont à tous les membres de ce mémoire pour leur contribution et tous les efforts qu'elles ont fait dans ce travail. DEDICACES.
Scene 8 (5m 40s)
[Audio] LISTE DES FIGURES : Figure 1: Le Martyre de Sainte Apollonia, autel des Onze-Mille-Vierges (1513), Münster von Heilsbronn (église abbatiale de Heilsbronn), Heilsbronn, Bavière, Allemagne. Figure 2: Instruments dentaires d'Ambroise Paré Figure 3 : Le dentiste par Villain 1825. BN Estampes Figure 4 : la vie de banard d'un métropolitain à kourou de Yvern Figure 5 :Adéle Blanc-sec : le mystère des profondeurs jacques Tardi Figure 6 : Evolution des prévalences de la peur, de l'anxiété, de la phobie dentaire et des problèmes de management du comportement chez les enfants et les adolescents Figure 7: Cercle vicieux du renoncement aux soins motivé par la peur Figure 8 : : Etiologies concernant l'apparition de l'anxiété ou de la peur face aux soins Figure 9 : Dessins d'enfants représentant une séance de soin dentaire et des problèmes de gestion de comportement au cabinet dentaire (Klingberg, 2009) Figure 10 : Echelle d'Image Faciale 18 Figure 11 : Venham Picture Test Figure 12 : le déroulement de prise en charge Figure 13 : patient phobique Figure 14 : masque nasal ou naso-buccal parfume et colore, de la taille de l'enfant Figure 15 : sédation consciente Figure 16 : modalité d'administration du MEOPA en endoscopie digestive Figure 17 : auto administration (DE Pr .CHERIFI) Figure 18 : Schémas simplifié de la luminothérapie Figure 19: la « Manchester Color Wheel » Figure 20 : PATIENT SOUS A.G (DE Pr .CHERIFI) Figure 21 : nombreux soins dentaires (DE Pr .CHERIFI).
Scene 9 (8m 24s)
[Audio] LISTE DES TABLEAUX : Tableau 1 : Questionnaire « Children-Fear Survey Schedule-Dental Subscale » (CFSS-DS) Tableau 2 : L'échelle de VENHAM Tableau 3 : Classification de l' « American Society of Anesthesiologists » (ASA) Tableau 4 : : Méthode de titration du Midazolam par voie intra-veineuse chez l'enfantpour l'obtention d'une sédation vigile Tableau 5 : les effets provoqués d'un mélange N2O-O2 en fonction de la teneur en N2O Tableau 6 : comparaison entre anesthésie générale et sédation consciente.
Scene 10 (9m 18s)
SOMMAIRE.
Scene 11 (9m 24s)
[Audio] Table des matières INTRODUCTION........................................................................................................................2 1. L'ANXIETE ET LA PHOBIE DENTAIRE .......................................................................2 1.1. Terminologie .........................................................................................................................2 1.1.1. Définitions .......................................................................................................................2 1.1.1.1. La peur .....................................................................................................................2 1.1.1.2. L'anxiété ..................................................................................................................2 1.1.1.3. La phobie..................................................................................................................2 1.1.1.4. L'Odontophobie .......................................................................................................3 1.1.2. Différence entre peur et anxiété .....................................................................................3 1.1.3 Distinction entre peur et phobie ......................................................................................4 1.2. Rappel ....................................................................................................................................6 1.2.1 L'histoire de la psychologie en odontologie.....................................................................6 1.2.2. L'odontophobie au fil du temps .....................................................................................8 1.2.2.1 l'odontophobie au travers l'histoire .........................................................................8 1.2.2.2 Les représentations actuelles du médecin-dentiste................................................. 12 2. ETIOLOGIES DE L'ODONTOPHOBIE CHEZ LES ENFANTS....................................... 15 1.1. Personnalité de l'enfant....................................................................................................... 15 1.1.1. Les différentes personnalités de l'enfant selon manara et sapelli ................................ 16 1.1.2. L'âge ............................................................................................................................. 16 1.1.3. Statuts socio-économiques ............................................................................................ 18 1.1.4. Origine ethnique ........................................................................................................... 18 1.1.5. Les parents .................................................................................................................... 19 1.1.6. Expérience antérieure désagréable .............................................................................. 20 1.1.7. Les notions d'incontrôlabilité, imprévisibilité et dangerosité des actes....................... 21 1.1.8 La perception de l'enfant du cabinet dentaire et de médecin dentiste ......................... 22 3. STRATEGIES DE PRISE EN CHARGE CHEZ UN ENFANT ODONTOPHOBIQUE : . 24 3.1. Signes physiologiques .......................................................................................................... 24 3.2. Les méthodes d'évaluation de l'anxiété .............................................................................. 25 3.2.1. L'auto-évaluation ......................................................................................................... 25 3.2.1.1. Les dessins .............................................................................................................. 25 3.2.1.2. L'échelle visuelle analogique (EVA) ..................................................................... 26 3.2.1.3. Venham Picture Test ............................................................................................. 27 3.2.2. L'hétéro-évaluation ...................................................................................................... 30 3.2.2.1. L'échelle de VENHAM (41, 72) ............................................................................. 30 3.2.2.2. L'Echelle de FRANKL (3) ..................................................................................... 32 3.2.2.3. L'Echelle de HOUPT (42) ...................................................................................... 32 3.2.2.3. L'Ohio State University Behavior Rating Scale (OSUBRS) (31) .......................... 32 4. LA PRISE EN CHARGE PROPREMENT DIT ................................................................... 35.
Scene 12 (14m 1s)
[Audio] 4.1. Avant la consultation........................................................................................................... 35 4.1.1. L'arrivée au cabinet dentaire ....................................................................................... 35 4.1.2. La salle d'attente ........................................................................................................... 35 4.1.3. La salle de soin .............................................................................................................. 35 4.1.4. La conception du cabinet dentaire ............................................................................... 36 4.2. La consultation .................................................................................................................... 36 4.2.1. Première consultation ................................................................................................... 36 4.2.2. Organisation des rendez-vous ...................................................................................... 37 4.3. Gestion du comportement de l'enfant ................................................................................. 38 4.3.1. L'état vigile ................................................................................................................... 38 4.3.1.1. Approche verbal..................................................................................................... 39 4.3.1.2. Approche non verbal ............................................................................................. 39 4.3.1.3. contrôles du comportement ................................................................................... 40 4.3.1.4. Gestion de la douleur ............................................................................................. 41 4.3.2. Sous prémédication sédative ........................................................................................ 43 6.3.2.1. Anxiolytiques.......................................................................................................... 43 4.3.2.2 Prémédication sédative : Anxiolyse ........................................................................ 44 4.3.2.3 Hydroxyzine (Atarax®) .......................................................................................... 44 4.3.2.4 Diazépam (Valium®) .............................................................................................. 45 4.3.2.5. Midazolam.............................................................................................................. 45 4.3.3. Sédation consciente par inhalation d'un mélange d'oxygène-protoxyde d'azote (MEOPA) ............................................................................................................................... 46 4.3.3.1 Matériel ................................................................................................................... 48 4.3.3.2 Mode d'administration ............................................................................................ 49 4.3.4. Luminothérapie et chromothérapie ............................................................................. 50 4.3.4.1 La luminothérapie................................................................................................... 50 4.3.4.2. La chromothérapie ................................................................................................. 53 4.3.5. L'anesthésie générale.................................................................................................... 59 4.3.6. la différence entre anesthésie générale et sédation consciente ................................. 62 CONCLUSION .......................................................................................................................... 63 BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................... 64.
Scene 13 (17m 48s)
[Audio] INTRODUCTION L'anxiété et la phobie dentaire sont très présentes dans notre société et ce, plus particulièrement chez les enfants. Elles peuvent être dues à de multiples facteurs comme une expérience négative, l'apprentissage par procuration d'un proche anxieuxou encore la position vulnérable adoptée dans le fauteuil dentaire. De plus, une mauvaise expérience durant l'enfance est responsable de la moitié des phobies dentaires chez l'adulte (10,12). Il est donc primordial d'instaurer, dès la première consultation de l'enfant un climat propice aux soins ou, s'il a déjà vécu une expériencenégative, de lever cette anxiété pour retrouver un enfant coopérant. Afin d'y parvenir, une relation de confiance doit s'instaurer entre les trois acteursdu soin, à savoir l'enfant, le parent et le praticien. En effet, la particularité del'odontologie pédiatrique repose sur l'établissement de cette relation tripodique dans laquelle chaque personnalité doit s'exprimer (5,47). En prenant en compte les étapes de développement de l'enfant et en évaluant sa capacité à coopérer, le soignant pourraadapter sa prise en charge. Si au contraire, cette appréhension n'est pas gérée, elle peut devenir un obstacle aux soins. Les actes préventifs sont alors retardés et l'enfantaura tendance à ne consulter qu'en cas de douleur. Ceci entretient alors le cercle vicieux du renoncement au soins motivé par la peur où les traitements auront d'avantage tendance à être symptomatiques et par ce fait, plus anxiogènes. Il est doncprimordial d'identifier ces obstacles et d'en atténuer les composantes pour ouvrir la voie à une meilleure santé bucco-dentaire et au bien-être général de l'individu (6). Dans le but d'améliorer cette prise en charge, il nous paraît opportun de mettreen lumière les origines de l'anxiété et de la phobie dentaire chez l'enfant. Leurs principales manifestations, les moyens d'évaluation ainsi que les méthodes de gestiony seront abordées. Enfin, une étude descriptive nous permettra d'illustrer les techniques employées par les praticiens de Nouvelle-Aquitaine afin de réduire l'anxiétédentaire..
Scene 14 (20m 18s)
[Audio] 1. L'ANXIETE ET LA PHOBIE DENTAIRE. 1. L’ANXIETE ET LA PHOBIE DENTAIRE.
Scene 15 (20m 25s)
[Audio] 2 L'anxiété et la phobie dentaire sont deux sentiments très différents qui peuvent avoir des conséquences majeures sur la prise en charge odontologique. Pour autant l'anxiété, l'angoisse et la phobie renvoient tous à un même phénomène : la peur. Ces différents termes sont par conséquent souvent confondus dans le langage courant. Afin de pouvoir les distinguer, ils vont donc être définis. 1.1. Terminologie 1.1.1. Définitions 1.1.1.1. La peur La peur est une réponse émotionnelle normale à la perception d'une menace ou d'un danger.Une réaction adaptative qui permet de faire face à la situation est alors déclenchée. Elle comprend des réactions cognitives et physiologiques, ainsi que des réponses comportementales telles que l'évitement des soins dentaires. Certaines peurs sont normales enfonction de l'âge. La peur devient pathologique lorsqu'elle n'est plus contrôlée, ni dans sonactivation, ni dans sa régulation (48) 1.1.1.2. L'anxiété L'anxiété correspond à un sentiment de danger imminent et indéterminé s'accompagnant d'un état de malaise, d'agitation. Les pensées négatives et catastrophiques dominent. Il y a anticipation des événements désagréables et sentiment de perte de contrôle. La peur est donc une composante centrale de l'anxiété mais, dans ce cas, les capacités d'adaptation sont dépassées et la réponse adaptative est excessive, inadéquate, inadaptée (48) 1.1.1.3. La phobie La phobie se caractérise par une peur intense, souvent incontrôlable, qui entraîne un évitementdes objets ou situations à l'origine du stress. La souffrance est extrême lorsque le sujet est confronté au facteur phobogène. La vie n'est pas mise en danger mais les phobies peuvent détruire la qualité de vie(48). Selon le « Diagnostic Manual of Mental Disorders » (DSM-IV) publié par l' « American Psychiatric Association », les critères pour le diagnostic.
Scene 16 (23m 7s)
[Audio] 3 d'une phobie spécifique, comme la phobie dentaire, sont : - Une peur marquée et persistante qui est excessive et déraisonnable ; - L'exposition aux stimuli phobiques provoque presque invariablement uneréponse anxieuse immédiate ; - La personne reconnaît que la peur est excessive (mais ce critère peut être absentchez les enfants) ; - La situation phobique est évitée ou endurée avec une anxiété ou une détresseintense. (39) 1.1.1.4. L'Odontophobie : L'odontophobie est une phobie spécifique caractérisée par une peur extrême, irrationnelle et persistante des soins dentaires ou de tout ce qui est lié à la dentisterie. Les personnes souffrant d'odontophobie éprouvent une anxiété intense à l'idée de se rendre chez le dentiste, même pour des soins dentaires de routine. Cette peur peut être tellement envahissante qu'elle peut empêcher ces individus de recevoir les soins dentaires nécessaires, ce qui peut entraîner des problèmes de santé bucco-dentaire plus graves à long terme.() 1.1.2. Différence entre peur et anxiété La peur est une réaction normale à un signal de danger réel. Dans une situation de danger, nous allons ressentir une tension physique et psychologique qui va nous aider à entrer en action pour se protéger. Par exemple devant une agression imminente, notre corps va se mettre soudainement dans un mode de combat en augmentant la contraction des muscles et en aiguisant nos sens. Ainsi, la peur est très utile pour se protéger et nous signaler qu'un danger est proche. Lorsque la peur est suffisamment contrôlable, il est possible de se préparer à la situation et d'anticiper le danger, mais quand elle est trop forte cela peut nous perturber et susciter un déséquilibre psychologique, On retrouve dans l'anxiété des caractéristiques similaires à celles de la peur telles que la tension physique et psychologique, mais l'anxiété n'est pas nécessairement générée par une situation réelle. En effet, l'anxiété peut survenir à la suite de l'anticipation d'un danger futur ou de quelque chose de très désagréable qui pourrait arriver, en l'absence parfois d'éléments réels..
Scene 17 (25m 37s)
[Audio] 4 Tout le monde éprouve de l'anxiété dans sa vie de tous les jours, elle peut être limitée dans le temps et avoir une intensité adaptée selon les situations de la vie. Par exemple, il est tout à fait normal d'éprouver de l'anxiété à la suite d'un examen ou d'un concours ; la crainte de ne pas obtenir son diplôme peut générer un sentiment de malaise mais cela ne doit pas paralyser son champ d'action. Ainsi, une quantité modérée d'anxiété peut susciter un regain d'énergie et de motivation, elle aide le corps et l'esprit à se préparer à faire face à quelque chose d'effrayant. Cependant, une quantité trop importante d'anxiété (intense ou durable) peut interférer avec les capacités d'une personne. 1.1.3 Distinction entre peur et phobie La peur et la phobie sont toutes deux des réactions émotionnelles liées à des stimuli spécifiques, mais il y a une différence importante entre les deux. La peur est une émotion normale et adaptative ressentie en présence d'une menace réelle ou perçue. Elle est souvent temporaire et disparaît une fois que la menace a été évitée ou surmontée. La peur peut varier en intensité et peut être liée à des objets, des situations ou des événements spécifiques. Par exemple, avoir peur des serpents, des hauteurs ou des espaces clos peut être considéré comme une peur normale. En revanche, la phobie est une peur intense et irrationnelle d'un objet, d'une situation ou d'un événement spécifique. Elle va au-delà d'une simple appréhension et peut entraîner une détresse émotionnelle significative. Les phobies sont souvent persistantes et peuvent interférer avec la vie quotidienne de la personne concernée. Par exemple, une phobie des araignées peut provoquer une réaction de panique extrême même en présence d'une araignée inoffensive. La principale différence entre la peur et la phobie réside dans l'intensité, la durée et le degré d'irrationalité de la réaction. Alors que la peur est une réponse normale à une menace.
Scene 18 (28m 0s)
[Audio] 5 réelle, la phobie implique une peur excessive et démesurée envers quelque chose qui ne présente pas nécessairement un danger réel..
Scene 19 (28m 10s)
[Audio] 6 1.2. Rappel 1.2.1 L'histoire de la psychologie en odontologie En histoire, l'Antiquité nous a laissé des mots et des objets . Concernant le traitement des dents. Au haut Moyen Âge, les moines avaient le niveau d'instruction le plus élevé et étaient donc détenteurs de connaissances médicales, dentaires et chirurgicales. A partir de 1500, les premiers écrits scientifiques commencent à apparaître de manière plus importante, avec le premier livre sur la dentisterie publié en Allemagne, suivi d'un livre complet contenant des enseignements sur le sujet par le "père de la chirurgie" Ambroise Paré. Au 18ème siècle, le chirurgien français Pierre Fauchard écrivit "Le Chirurgien Dentiste" ou "Traité des Dents", qui pour la première fois décrivait le système buccal, incluant les principes de l'anatomie buccale, les techniques de restauration… ; mais jusqu'à ici la psychologie était absente dans la pratique dentaire. Ce n'est qu'en 1981 qu'une "Revue d'Odontologie" a montré au public que la psychologie avait pris une place importante parmi les priorités professionnelles des dentistes. Mais au fil des générations, les capacités technologiques et scientifiques accrues de l'industrie n'ont fait que ternir l'image mentale. De plus, il est conseillé aux dentistes de comprendre l'impact psychologique de leurs gestes thérapeutiques et techniques afin de respecter l'identité du patient, rendant ainsi la pratique dentaire plus efficace et enrichissante. C'est là qu'émergent des travaux très importants dans le domaine de la psychodentologie, alors que nous commençons à examiner les origines et les caractéristiques possibles de l'anxiété dentaire. Il s'agit d'un facteur majeur dans le changement de comportement des patients, il est donc essentiel de mener cette recherche. Bien que la psychologie ait toujours été très étroitement associée à la philosophie, le véritable développement de la science psychologique a pris forme surtout à partir des années 1800. La psychologie comportementale a acquis une importance et une popularité énormes au milieu du 20e siècle et la dentisterie comportementale a de fait beaucoup hérite de la psychologie comportementale vu que les lois de l'apprentissage qui la régissent se caractérisent surtout par leur pragmatisme et leur applicabilité a court terme. Les expériences de Watson (1920) et de Pavlov (1927) et le concept de stimuli (causes) et de réponses (effets) dans les relations homme-environnement ont fait progresser l'étude du comportement..
Scene 20 (31m 9s)
[Audio] 7 La théorie du conditionnement de Pavlov expliquerait l'acquisition de nouveaux comportements ou capacités à cette époque : l'attitude humaine serait passive. Il convient de considérer, néanmoins, que le pragmatisme de la psychologie comportementale offre des outils concrets aidant a comprendre le présent et a connaitre les moyens qui permettent a l'homme d'acquérir de nouveaux comportements . Les avantages qui se révèlent importants pour la dentisterie sont la flexibilité et la façon moins mécaniste dont la psychologie comportementale est appliquée aujourd'hui, ce qui facilite la résolution des problèmes et la réponse a des besoins. Selon Maurice Bourassa, qui développé avec une grande maitrise le sujet de la dentisterie comportementale, vers le milieu du siècle passe, la psychologie comportementale a eu une bonne notoriété. Cependant par la suite, surtout avec le développement de la psychologie cognitive, quelques reproches sont destinées a la psychologie comportementale concernant son ( manque de flexibilité et l'absence d'intérêt pour les aspects cognitifs, existentiels ou affectifs du vécu humain ). Etant donne que la psychologie cognitive accorde de l'importance aux sentiments et aux données subjectives de l'expérience humaine, elle est amenée a supplanter la psychologie comportementale et en effet, Bourassa (1998) nous rappelle que ce déclin coïncide avec le développement d'une attention plus marquée a la qualité de vie et a la sante publique. Il faut encore citer les psychologues Albert Bandura (1969) et William J. Mahoney (1976) et leurs travaux sur les principes de l'évaluation cognitive dans la formation des phobies. L'introduction des éléments cognitifs permet d'expliquer certains comportements relies aux mécanismes de la pensée..
Scene 21 (33m 13s)
[Audio] 8 1.2.2. L'odontophobie au fil du temps : 1.2.2.1 l'odontophobie au travers l'histoire : Les problèmes dentaires sont fréquents et ont une longue histoire. En effet, dès les temps préhistoriques, les chasseurs-cueilleurs souffraient de problèmes tels que la récession osseuse des gencives, les caries et donc, une détérioration de la structure de leurs dents. Environ 5000 ans avant notre ère, les Babyloniens invoquaient leur dieu Enki pour combattre le ver responsable des douleurs dentaires. Cette croyance persista pendant le Moyen Âge et même pendant la Renaissance. En conséquence, différentes méthodes et traitements furent développés au fil du temps, avec des variations selon les époques. Ces pratiques ont contribué à la naissance et à l'intensification de la peur envers les dentistes. Au cours l'antiquité : Remontant à 1500 ans avant notre ère, le papyrus d'Ebers contient de nombreuses informations sur la médecine générale et la dentisterie. Les remèdes mentionnés à l'époque étaient basés sur des incantations, de la magie et des plantes. Des pratiques de plus en plus préoccupantes ont ensuite vu le jour : - En Égypte ancienne, les problèmes dentaires étaient traités en ingérant des souris cuites et écorchées. - En Grèce antique, on importait de l'urine espagnole en provenance de Barcelone ou de Tarragone pour soigner les maux de dents. - Certains remèdes pouvaient même inclure des cendres provenant de têtes de chiens morts, ainsi que des vers de terre bouillis dans de l'huile.- Quant aux Romains, ils remplissaient les cavités des caries avec une poudre composée d'excréments de souris et de foie de lézard, qu'ils recouvraient ensuite de cire..
Scene 22 (35m 18s)
[Audio] 9 Au cours du Moyen-âge : À cette époque, l'art dentaire était pratiqué à la fois par des barbiers et des charlatans. Les barbiers étaient à la fois des artisans de la coiffure et des chirurgiens. En raison de restrictions religieuses et universitaires, les médecins n'étaient pas autorisés à pratiquer la chirurgie. Les charlatans, quant à eux, ont grandement contribué à ternir la réputation des dentistes en trompant les patients et en cherchant à s'enrichir. Quelques figures marquantes se sont néanmoins distinguées à cette époque : Rhazès, le premier médecin arabe à s'intéresser aux dents, croyait que la douleur dentaire cessait une fois que la couronne était enlevée. Une autre méthode consistait même à faire éclater la dent en utilisant un vinaigre très fort ou du salpêtre. Avicenne, quant à lui, pratiquait la trépanation de la couronne pour libérer les liquides provenant de l'inflammation de la pulpe dentaire. Il est important de noter que la première anesthésie locale à base de cocaïne a été introduite en 1889 et que l'ensemble des soins décrits ici devaient causer d'insupportables douleurs aux patients. Les dents pouvaient donc être une source de souffrances atroces. En fait, certaines tortures ciblaient spécifiquement la région bucco-dentaire. Le martyre de sainte Apolline en est un exemple. Ses persécuteurs lui ont frappé les maxillaires et lui ont arraché les dents. La pauvre préféra alors se jeter dans un bûcher déjà allumé et y périr brûlée vive. Figure 1: Le Martyre de Sainte Apollonia,autel des Onze-Mille-Vierges (1513),Münstervon Heilsbronn (église abbatiale deHeilsbronn), Heilsbronn, Bavière, Allemagne..
Scene 23 (37m 25s)
[Audio] 10 Au cours de la renaissance : Les connaissances médicales se sont considérablement étendues pendant la Renaissance grâce aux nombreuses recherches sur l'anatomie qui étaient auparavant limitées par les autorités ecclésiastiques. De plus, la diffusion du savoir a été favorisée par l'avènement de l'imprimerie. Ambroise Paré, célèbre barbier né en 1510, s'est beaucoup intéressé à la chirurgie dentaire. Il procédait donc à l'extraction des dents en utilisant divers instruments tels que le Tiretoir (semblable à un outil utilisé pour enfoncer les cercles de tonneaux), le levier (semblable à des "pieds-de-biche") ou encore le Pélican. Malheureusement, souvent la dent à extraire n'était pas la seule à être arrachée. Les dents voisines et des fragments de maxillaire étaient également retirés. Par ailleurs, Ambroise Paré décrivait des soins basés sur d'anciennes méthodes, comme la cautérisation au fer rouge et le traitement à base d'ail ou d'oignon pour tuer le ver qui rongeait la dent. Figure 2: Instruments dentaires d'Ambroise Paré Pierre Fauchard, considéré comme le père de la chirurgie dentaire moderne, recommandait tout de même l'utilisation d'excréments animaux (animalia excreta) ainsi que d'urine de jeunes garçons..
Scene 24 (38m 59s)
[Audio] 11 Lazare Rivière, quant à lui, prétendait soulager les douleurs dentaires en appliquant directement ses remèdes dans le conduit auditif externe, car il supposait que les veines nourricières des dents passaient par l'oreille. Fauchard dénonça la tromperie des charlatans qui prétendaient extraire des dents sans aucune douleur en utilisant leur sabre. « Ils tiennent une dent préparée dans leur main, enveloppée dans une fine membrane contenant du sang de poulet. Ils insèrent leur main dans la bouche du supposé patient et y laissent la dent qu'ils avaient cachée ; ensuite, ils font semblant de toucher la dent avec la pointe de leur épée, puis font retentir la clochette et le patient crache devant les spectateurs ébahis une dent et du sang en abondance ». Figure 3 : Le dentiste par Villain 1825. BN Estampes Il est donc facile de comprendre les préjugés négatifs envers les chirurgiens-dentistes, principalement nourris par ces pratiques charlatanesques qui ternissent encore notre profession aujourd'hui. Il a fallu attendre le 30 novembre 1892 pour que la loi Brouardel établisse que personne ne peut exercer la profession de dentiste sans être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste..
Scene 25 (40m 26s)
[Audio] 12 1.2.2.2 Les représentations actuelles du médecin-dentiste : A travers les bandes dessinées : La bande dessinée, considérée comme le "neuvième art", présente de nombreuses caricatures et représentations de l'odontologie. À travers elle, les stéréotypes à l'encontre des dentistes sont maintenus, alimentant ainsi les appréhensions de certains patients. Dans cette caricature tirée de "La vie de bagnard d'un métropolitain à Kourou", le dessinateur Yvern dépeint le dentiste comme une personne de petite taille, hargneuse et effrayante. On le voit debout sur son patient, utilisant un marteau-piqueur pour extraire une dent, sans se soucier de sa douleur. Le pauvre homme se débat, crie et saigne abondamment. Malgré le ton humoristique de cette représentation, il est facile de comprendre comment une telle image peut discréditer la profession de médecine-dentiste et susciter la peur chez nos patients. Figure 4 : la vie de banard d'un métropolitain à kourou de Yvern Dans cette scène, Bercovici Cauvin présente un dentiste de manière surprenante, le représentant avec une pioche, une corde et une lampe frontale. Une fois de plus, le cliché est exagéré. Les instruments mis en avant ne sont pas ceux réellement utilisés par le praticien, mais le patient pourrait les imaginer comme tels. Dans le livre "Spirou et les hommes bulles", le protagoniste entre par une fenêtre et découvre un cabinet dentaire qu'il assimile à un laboratoire pour effectuer des opérations monstrueuses. Une fois de plus, l'auteur entretient la peur du dentiste en associant le cabinet dentaire à un lieu de torture..
Scene 26 (42m 28s)
[Audio] 13 Dans cette scène extraite de "Adèle Blanc-Sec : le mystère des profondeurs", on voit une jeune femme en salle d'attente qui entend les hurlements du patient en consultation avec le dentiste. La douleur au cabinet dentaire semble inévitable ici, alors que la dentisterie moderne a considérablement progressé pour offrir un meilleur confort aux patients et les soulager au maximum. Aller chez le dentiste de nos jours ne devrait plus être synonyme de douleur selon nos patients... Il est évident qu'il existe un écart entre les efforts déployés par les chirurgiens-dentistes pour améliorer la gestion de la douleur et de l'anxiété des patients, et la représentation que ces derniers ont des soins dentaires. Figure 5 :Adéle Blanc-sec : le mystère des profondeurs jacques Tardi La même idée est critiquée dans cette case. Le praticien semble dépourvu d'empathie et ordonne à son patient de rester immobile, pendant que ce dernier souffre atrocement. Il convient de noter que le dentiste réalise une anesthésie locale. Cet acte est diabolisé, bien qu'en réalité il ne provoque pas de douleurs atroces. Cela renforce les craintes que le patient peut entretenir, en particulier lors de l'étape de l'administration de l'anesthésie par injection.
Scene 27 (43m 59s)
[Audio] ETIOLOGIES DE L'ODONTOPHOBIE CHEZ LES ENFANTS.
Scene 28 (44m 7s)
[Audio] 15 2. ETIOLOGIES DE L'ODONTOPHOBIE CHEZ LES ENFANTS L'importance de l'odontophobie par rapport à d'autres spécialités médicales peut notamment être expliquée par la symbolique majeure et la signification primaire de la sphère orale. En effet, elle possède une grande charge émotionnelle et participe activement au développement psychique de l'enfant. Elle est le premier lieu de plaisir par la succion et la satisfaction de faim ; un moyen de découverte du monde par sa richesse en propriocepteurs ; le siège des premières grandes douleurs lors des poussées dentaires ; un moyen de défense par l'expression de colère ou le pouvoir de morsure ainsi qu'un puissant vecteur de communication par le sourire et le langage(47). Outre cette symbolique et bien que l'histoire de l'apprentissage précoce semble jouer un rôle dans le développement initial de l'anxiété dentaire, ces phénomènes restent multifactoriels et d'origines complexes. Les facteurs personnels, environnementaux et situationnels interagissent. Les enfants varient en âge, en compétence, en tempérament, en personnalité, en capacité intellectuelle et en maturité. Ils diffèrent aussi par leur expérience de vie, la situation familiale et le contexte culturel. Tous ces aspects affectent la capacité de l'enfant ou de l'adolescent 16à tolérer les examens dentaires et le traitement, de plus, ces facteurs semblent s'entrecroiser dans une relation très complexe (7–30). 2.1. Personnalité de l'enfant Chaque enfant possède sa propre personnalité en lien avec son stade de développement. D'après le Larousse, la personnalité d'un individu est l'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres (42). Chaque réaction peut donc être différente. Néanmoins, face à une situation perçue comme stressante, l'enfant ne reste habituellement pas passif. Le « coping » ou « stratégie d'ajustement » désigne l'ensemble des processus mis en oeuvre par un individu pour faire face à cette situation. Ces processus permettent de diminuer, tolérer ou maîtriser l'impact de la situation sur son bien-être physique et psychologique (4). Lorsqu'un enfant est face à une situation qu'il considère comme génératrice de stress, il met en place différentes types de stratégies. Elles peuvent être de nature cognitive (essayer de penser à autre chose), émotionnelle (se mettre à pleurer), somatique (perdre l'appétit), comportementale (refuser d'ouvrir la bouche), mais aussi relationnelle (appeler ses parents) (46)..
Scene 29 (47m 18s)
[Audio] 16 2.1.1. Les différentes personnalités de l'enfant selon manara et sapelli Ils ont établi une classification s'appliquant aux enfants au fauteuil. Coopérant ; il ne pose pas de problème car il a totalement confiance en ce qu'on lui fait. L'enfant qui a peur ou qui est anxieux peut être très coopérant. Ce mal-être se lira essentiellement à travers l'expression faciale et le langage du corps. Qui collabore mais est tendu ; c'est un enfant parfaitement coopérant car il veut montre qu'il est à la hauteur de la situation vis-à-vis du dentiste, de lui-même et de ses parents Rebelle ; Habitué à ce qu'on lui cède, il se comporte avec le dentiste comme avec ses parents. Il est impoli, impertinent, habitué à n'en faire qu'à sa tête peureux ; Il se réfugie dans les coins, il veut s'enfuir, il a le regard terrorise et implorant. Il est absolument impossible de soigner cet enfant qu'il n'aura pas réglé son problème de peur Craintif ; Indécis, il demande des explications, pleurniche même parfois et ne sait que faire Emotif ;Son comportement est imprévisible, étant donné sa fragilité émotive, sont hyperesthésie. Comportement de self-défense ; Ces comportements ont pour but de retarder au maximum les soins prodigues par le praticien. Shinohara et coll. En ont retenu 3 appartenant à cette catégorie*mettre ses mains sur sa poitrine,*retenir les mains du dentiste*agiter des jambes de bas en haut. 2.1.2. L'âge À mesure qu'un enfant grandit, il traverse différentes périodes clés au cours desquelles il développe de nouvelles compétences. La peur du dentiste est plus fréquente chez les jeunes enfants en raison de leur développement psychologique et de leur capacité à coopérer lors des traitements(39). Les tout-petits sont souvent anxieux dans de nouveaux environnements, et cela est encore plus prononcé lorsqu'ils se rendent dans un cabinet dentaire où ils peuvent être effrayés par les bruits et les instruments qui les entourent. Par conséquent, il est recommandé.
Scene 30 (49m 59s)
[Audio] 17 d'introduire l'enfant dès son plus jeune âge dans cet environnement afin qu'il puisse s'y habituer. Avant l'âge de 4 ans, l'enfant n'est pas capable de distinguer un danger imaginaire d'un danger réel. Il n'aime pas non plus être laissé seul, il est donc préférable que l'adulte de référence soit présent dans la salle de soins. En grandissant, l'enfant développe ses compétences cognitives, ce qui lui permet de mieux gérer sa peur. À l'âge de 4 ans, son imagination est très vive et sa curiosité est élevée, ce qui fait des symboles de bons moyens de communication. À l'âge de 6 ans, cependant, l'enfant commence à adopter une pensée plus logique, ce qui rend plus difficile de le convaincre. En grandissant, il apprend à intégrer des règles et devient de plus en plus responsable, jusqu'à l'adolescence, une période de conflit avec l'autorité. Les adolescents sont très sensibles à la critique et veulent être considérés comme des adultes lorsqu'ils sont sur le fauteuil dentaire(47). Selon leur stade de développement socio- émotionnel, les enfants seront plus ou moins en mesure d'accepter un traitement dentaire et d'en comprendre l'importance. Leur anxiété ou leur peur peuvent varier. La peur et les problèmes de gestion du comportement dentaire sont fréquents chez les jeunes enfants et ont tendance à diminuer avec l'âge, en particulier grâce à la familiarisation avec le lieu et les procédures. L'anxiété et l'odontophobie sont souvent le résultat d'un événement vécu comme négatif. Cependant, la première consultation dentaire en France a en moyenne lieu à l'âge de 4,5 ans et seulement 4% des enfants de moins de 6 ans ont recours aux soins dentaires. Ces phénomènes ne sont donc pas présents chez les tout-petits, mais ils augmentent avec l'âge.(27,40,47).
Scene 31 (52m 8s)
[Audio] 18 Figure 6 : Evolution des prévalences de la peur, de l'anxiété, de la phobie dentaire et desproblèmes de management du comportement chez les enfants et les adolescents (40) 2.1.3. Statuts socio-économiques En plus l'attitude des parents face aux traitements dentaires, les représentations du soin sont, d'une manière générale, différentes selon les classes socioprofessionnelles et les modèles familiaux. Il est admis que les personnes à faible revenu et dont le niveau d'éducation est relativement bas ont des attitudes plus négatives à l'égard des soins dentaires. En effet le renoncement aux soins est deux fois plus important dans les classes sociales défavorisées (27). Ce phénomène est renforcé par l'isolement géographique engendré par la pauvreté qui rend l'accès aux soins plus difficile. L'éducation aurait également un impact sur la coopération lors des soins dentaires et ce d'autant plus que, de nos jours, les enfants contestent fréquemment l'autorité (39). De surcroît, ces familles ont une attitude moins positive face aux actes préventifs et auront tendance à ne consulter qu'en cas de douleurs, ce qui entretient le cercle vicieux de l'anxiété (Figure 10) (6,7,14,48,54). 2.1.4. Origine ethnique Les facteurs ethniques et socio-culturels influent aussi sur l'accès aux soins. Une mauvaise compréhension liée à la barrière de la langue ou encore des croyances culturelles.
Scene 32 (53m 58s)
[Audio] 19 sur la santé bucco-dentaire et les traitements peuvent également affecter le rapport aux soins de l'enfant (54). La distance entre dogmes sanitaires et alimentaires occidentaux et ceux de la culture familiale est parfois grande (47). En effet, un traitement peut être refusé si le patient estime que ses croyances sont violées ou non respectées. De plus, les gestes occidentaux coutumiers estimés comme polis ne sont pas toujours bien accueillis selon l'origine ethnique. Par exemple, un contact visuel prolongé est généralement considéré comme un signe de confiance dans la culture occidentale alors qu'elle peut suggérer un manque de respect dans la culture musulmane. Ces défauts d'interprétation peuvent, eux aussi, créer une entrave au bon déroulement des soins (5). 2.1.5. Les parents Il est admis que l'anxiété dentaire des proches influe grandement sur les capacités d'adaptation et d'apprentissage de l'enfant mais aussi sur le niveau d'anxiété éprouvée (47). L'anxiété parentale peut avoir une incidence dans la mesure où le parent retarde la visite de son enfant chez le dentiste pour des soins préventifs précoces et réguliers. Un tel schéma est une entrave aux soins puisque l'enfant ne consultera qu'à un stade de dégradation avancé de sa santé bucco-dentaire et augmente la probabilité qu'un traitement symptomatologique survienne tôt dans son histoire dentaire (Figure 6). Figure 7 : Cercle vicieux du renoncement aux soins motivé par la peur (5–6).
Scene 33 (55m 46s)
[Audio] 20 Les parents façonnent les manières de penser et d'agir de leurs enfants. D'après la littérature, une attitude négative de la famille vis-à-vis des soins dentaires est une des causes fréquentes de développement d'odontophobie (47,54). Celle-ci est répandue au point qu'elle est le second facteur de renoncement aux soins, après l'obstacle financier. En effet, 25% des patients ne consultent pas leur chirurgiendentiste pour cette raison. (21) 2.1.6. Expérience antérieure désagréable Il est courant de rencontrer des patients qui expriment leur peur des soins dentaires en se référant à une expérience traumatisante antérieure. En effet, les expériences douloureuses et traumatisantes chez le dentiste sont associées à l'anxiété et à la peur des soins. Une étude réalisée par Armfield a révélé que près de 70% des personnes ayant une forte peur avaient déjà vécu une douleur intense chez le dentiste, contre seulement 37,9% des personnes ayant peu ou pas d'anxiété ou de peur liées aux soins dentaires. Il s'agit en réalité d'un conditionnement cognitif de type pavlovien. C'est un processus par lequel un stimulus neutre au départ acquiert la capacité de déclencher une réponse conditionnée après avoir été associé à un stimulus inconditionnel. Ainsi, si un patient ressent de la douleur lors d'un traitement dentaire, il peut développer une peur conditionnée lors des prochaines consultations. La douleur devient associée au dentiste. Le patient a donc appris par son expérience personnelle que cette situation annonce un événement préjudiciable. Watson et son équipe ont mené des expériences sur des nourrissons pour démontrer ce processus. Lorsque des stimuli non effrayants et des stimuli effrayants étaient associés, une réponse émotionnelle effrayante était déclenchée chez l'enfant. Par la suite, le simple stimulus non effrayant suffisait à provoquer la même émotion. Cependant, Armfield a constaté que certains patients ayant vécu une expérience traumatisante ne développaient pas de peur, tandis que d'autres développaient une peur sans avoir été exposés auparavant à une telle expérience. Ainsi, il considère que l'approche cognitive joue un rôle central dans l'acquisition de la peur, plutôt que les expériences passées..
Scene 34 (58m 31s)
[Audio] 21 2.1.7. Les notions d'incontrôlabilité, imprévisibilité et dangerosité des actes Comme expliqué précédemment, Armfield soutient que la perception du danger est plus importante que l'expérience passée douloureuse et/ou traumatisante d'un individu. Il a donc examiné l'association entre la peur des soins dentaires et les perceptions du patient telles que le sentiment de contrôle, l'imprévisibilité et la dangerosité. Il s'avère que la perception du manque de contrôle et de la dangerosité est significativement liée à un niveau élevé de peur. Cependant, ce n'est pas le cas de l'imprévisibilité, bien qu'elle joue néanmoins un rôle important dans l'approche cognitive du patient, car cette notion peut se confondre avec celles de danger et de contrôle. Armfield parle alors d'un "schéma de vulnérabilité". L'exposition à une situation ou à un stimulus affecte les perceptions du patient. Cela entraîne une réponse affective automatique et une évaluation générale qui se traduisent par une série de réactions physiologiques, comportementales, cognitives et émotionnelles. Par conséquent, l'expérience de la visite chez le dentiste combinée aux perceptions et émotions ressenties déterminent les réactions lors de futures visites chez le dentiste. Figure 8 : Etiologies concernant l'apparition de l'anxiété ou de la peur face aux soins dentaires et des problèmes de gestion de comportement au cabinet dentaire (Klingberg, 2009) *DBMP (« Dental Behavior Management Problem ») est un terme employé par l'équipe soignante pour désigner les comportements non-coopérants et perturbateurs entraînant unretard ou rendant le soin impossible.
Scene 35 (1h 0m 34s)
[Audio] 22 2.1.8 La perception de l'enfant du cabinet dentaire et de médecin dentiste Lorsque l'enfant perçoit le cabinet dentaire et le médecin dentiste comme un environnement hostile, un lieu inconnu, ou qu'il a des préjugés concernant les instruments utilisés, cela peut avoir un impact significatif sur son expérience et sa perception des soins dentaires. Environnement hostile : Un environnement dentaire perçu comme hostile peut être dû à divers facteurs tels que des couleurs ternes, des lumières vives, des odeurs désagréables ou une propreté perçue comme insatisfaisante. L'aspect froid et clinique du cabinet dentaire peut créer une atmosphère intimidante et susciter de l'anxiété chez l'enfant. Lieu inconnu : Pour un enfant, se rendre dans un cabinet dentaire peut être une expérience nouvelle et inconnue. L'absence de familiarité avec l'environnement, les procédures et le personnel peut contribuer à une appréhension accrue. L'enfant peut craindre l'inconnu et avoir du mal à se sentir à l'aise dans un lieu où il ne sait pas à quoi s'attendre. Instruments et équipements dentaires : Certains instruments dentaires peuvent sembler intimidants ou effrayants pour un enfant. Les bruits des instruments, tels que les perceuses ou les aspirateurs, peuvent être perçus comme désagréables ou menaçants. De plus, la vue des aiguilles ou d'autres instruments pointus peut susciter de l'anxiété et des peurs chez l'enfant. Préjugés et stéréotypes : Les enfants peuvent être exposés à des préjugés et à des stéréotypes concernant les visites chez le dentiste à travers les médias, les récits d'autres personnes ou même leurs pairs. Des représentations négatives, exagérées ou déformées peuvent créer une perception erronée des soins dentaires et renforcer les craintes de l'enfant. Ces facteurs peuvent contribuer à une appréhension accrue, à de l'anxiété et à une résistance aux soins dentaires. Il est important de prendre en compte ces préoccupations et de mettre en place des stratégies adaptées pour aider l'enfant à surmonter ses craintes. Les dentistes pédiatriques spécialisés comprennent l'importance de créer un environnement accueillant, de rassurer l'enfant et de lui expliquer les procédures de manière adaptée à son âge et à sa compréhension..
Scene 36 (1h 3m 12s)
[Audio] STRATEGIES DE PRISE EN CHARGE CHEZ UN ENFANT ODONTOPHOBIQUE.
Scene 37 (1h 3m 23s)
[Audio] 24 3. STRATEGIES DE PRISE EN CHARGE CHEZ UN ENFANT ODONTOPHOBIQUE : Lors de la pratique quotidienne, il est indispensable d'évaluer l'odontophobie des patients afin de pouvoir faire les bons choix thérapeutiques. Chaque enfant réagit différemment face à la même situation, et le même enfant peut adopter une attitude variable en fonction des jours et des circonstances des soins. Les directives internationales actuelles mettent en évidence l'importance d'évaluer le patient et de comprendre les causes de sa peur. Cela nous permettra d'adopter une stratégie personnalisée adaptée à chaque patient. Pour mener à bien cette évaluation, il est donc essentiel d'utiliser des outils validés. 3.1. Signes physiologiques L'anxiété est une émotion qu'il reste possible de déceler chez nos patients. Certains signes cliniques peuvent traduire la crainte d'un individu. Parmi eux nous retrouvons : Des tensions musculaires ; une étude menée avec 59 patients en ambulatoire a rapportée des tensions musculaires chez 64% des sujets. Une hyperventilation ; cette même étude a également constate une accélération de la respiration chez 37% des sujets. Une tachycardie ou une bradycardie ; Lorsqu'une personne est confrontée à un stress intense, le système nerveux sympathique accélère le métabolisme. Cela se produit en cas de danger ou de peur, préparant ainsi l'individu à se battre ou à fuir (fight or flight). On observe alors une augmentation du rythme cardiaque en raison de la libération de catécholamines. Cependant, des études ont révélé qu'en cas de menace perçue, la fréquence cardiaque ralentit. La sensation de menace entraîne une augmentation de la pression artérielle par le biais du système sympathique. Par conséquent, la diminution de la fréquence cardiaque pourrait être une réponse réflexe des barorécepteurs. Ce phénomène ressemble à la bradycardie de peur observée chez les animaux. Une augmentation de la pression artérielle ; On peut constater chez les patients craintifs une accélération de la pression artérielle, ainsi que de la fréquence cardiaque. Une sudation profuse ; Il est possible de la constater sur le visage de nos patients ou plus fréquemment sur leurs mains lorsque celles-ci deviennent « moites »..
Scene 38 (1h 6m 21s)
[Audio] 25 Des crampes d'estomac et des nausées ; Le patient peut également se plaindre d'avoir mal au ventre, ou bien de se sentir nauséeux et d'avoir des haut-le-cœur lors de la consultation. 3.2. Les méthodes d'évaluation de l'anxiété : La description du sentiment d'anxiété éprouvé va permettre de le rendre compréhensible pour ceux qui en sont témoin. Pour cela, différentes méthodes d'évaluation de l'anxiété et du comportement sont disponibles. Une échelle doit être fiable (cohérente et reproductible) et adaptée aux enfants, surtout lorsqu'il s'agit d'auto-évaluation. Cette pluralité rend la comparaison difficile entre les études qui n'emploient pas les mêmes méthodes. La prévalence de l'anxiété dentaire est également très variable selon les échelles utilisées (29). Pour illustrer ceci, quelques techniques d'auto- et d'hétéro-évaluation vont être décrites. 3.2.1. L'auto-évaluation : Les méthodes d'auto-évaluation de l'anxiété dentaire se basent sur le ressenti de l'enfant qui indique le sentiment qu'il éprouve face aux différentes étapes du rendez- vous. Ces tests sont plus faciles à mettre en place que les hétéro-évaluations car ils ne requièrent pas d'interprétation de la part du praticien. Enfin, l'aspect subjectif des réponses doit être pris en compte afin de ne pas sous- ou sur-évaluer cette anxiété. 3.2.1.1. Les dessins : l'enfant doit réaliser une représentation de lui-même au cours d'une séance de soins, ce qui permet de supprimer le côté subjectif d'une personne intermédiaire... L'interprétation est faite en fonction des couleurs et formes utilisées par l'enfant (60). Malgré les difficultés d'interprétation et le manque de fiabilité, cette méthode reste bien adaptée pour les petits enfants. L'enfant a manifestement gardé une bonne image de sa séance chez le dentiste,le papillon et la fleur autour des soignants témoignent du côté apaisant et positif de sa perception. Dessin réalisé dans l'UF de sédation consciente du Pôle d'Odontologie du CHU deNice (Hôpital Saint Roch). Ici, la perception de l'enfant est plus contrastée... Les mains des praticiens, notamment, sont hypertrophiées... L'enfant est représenté soumis, les brasécartés, presque "effacé" sous le fauteuil dentaire....
Scene 39 (1h 9m 15s)
[Audio] 26 Dessin réalisé dans l'UF desédation consciente du Pôle d'Odontologie du CHU de Nice (Hôpital Saint Roch). Figure 9 : Dessins d'enfants représentant une séance de soin dentaire 3.2.1.2. L'échelle visuelle analogique (EVA) : Elle comprend des chiffres de 1 à 10 et l'enfant situeson niveau d'anxiété entre ces deux limites. Le questionnaire : Echelle d'auto-évaluation L'échelle dentaire de Corah CDAS (Corah Dental Anxiety Scale), développée par NL Corah en 1969, présente quatre questions à choix multiples (33, 51) : - la première concerne sa réaction à l'idée de se rendre chez le chirurgien-dentiste, cinq réponses sont possibles (je vois cela comme une expérience agréable, cela ne m'inquiète pas particulièrement, ça me met un peu mal à l'aise, j'ai peur que cela soit douloureux et désagréable ou je suis vraiment stressé par ce que le dentiste va pouvoir me faire). - la deuxième concerne le sentiment ressenti dans la salle d'attente (relaxé, un peu mal à l'aise,tendu, anxieux ou bien tellement anxieux que je me sens malade). - la troisième concerne le sentiment sur le fauteuil avant le début du soin (mêmes propositionsque précédemment)..
Scene 40 (1h 10m 52s)
[Audio] 27 - la dernière concerne le sentiment lors du soin (mêmes propositions que précédemment). Un score de 1 à 5 est attribué à chaque réponse. Le score total se situe donc entre 4 (score pour lequel le patient n'exprime pas d'anxiété) et 20 (score pour lequel le patient est extrêmement anxieux). Quand le score est inférieur à 8, cela signifie que le patient est faiblement anxieux, entre 8 et 12, il est considéré comme moyennement anxieux et quand il est supérieur à 12, il est fortement anxieux Figure 10 : Echelle d'Image Faciale 18 3.2.1.3. Venham Picture Test : Le « Venham Picture Test » est une auto-évaluation. Elle est constituée de huit images où chacune représente un enfant anxieux et un non-anxieux au cours de différentes étapes du rendez-vous (Figure 10). L'enfant doit choisir à chaque moment le personnage qui le représente le mieux. Le score minimum est donc de 0 et le maximum de 8. Ce test est un bon moyen d'évaluer l'anxiété dentaire de l'enfant au cours de la séance. En effet, il est facile à mettre en place au cours d'une séance clinique et est adapté aux enfants dès le plus jeune âge (29,62). Il présente cependant quelques limites puisque tous les personnages sont masculins, les petites filles peuvent avoir du mal à s'y référer. De plus certaines figures sont ambiguës dans ce qu'elles représentent comme l'image 4 où il n'est pas aisé de différencier le.
Scene 41 (1h 12m 45s)
[Audio] 28 personnage coopérant de celui renfrogné (18). Figure 11 : Venham Picture Test (17,62) 3.2.1.4. Children-Fear Survey Schedule-Dental Subscale: Le « Children-Fear Survey Schedule-Dental Subscale » (CFSS-DS) est un moyen d'auto-évaluation de l'anxiété qui ne tient compte que de l'éprouvé. Pour répondre à ce questionnaire de 50 items (Tableau 3), l'enfant doit savoir lire et comprendre les questions qui lui sont posées. Il doit qualifier son sentiment selon l'échelle de Lickert, de 1 (pas du tout effrayé) à 5 (très effrayé). Un score moyen rapporté au nombre d'items est ensuite déterminé (48). Ce test peut cependant être considéré comme relativement obsolète car il ne respecte pas les recommandations actuelles de gestion du comportement. En effet, il emploie des mots à connotation négative comme « piqûres » ou des mots non adaptés au langage d'un enfant comme « fraiser » ce qui peut fausser les réponses de l'enfant..
Scene 42 (1h 14m 5s)
[Audio] 29 L'enfant doit qualifier son sentiment (pas effrayé du tout, un petit peu effrayé, assez effrayé, effrayé ou très effrayé) dans les situations suivantes : Chez un médecin Chez un dentiste Avoir des piqûres Aller à l'hôpital Les gens en blouse blanche Un étranger qui te touche Quelqu'un qui te regarde Devoir ouvrir la bouche Avoir des instruments dans la bouche Le dentiste qui fraise Voir le dentiste fraiser Le bruit de la fraise S'étouffer Le dentiste qui te brosse les dents Tableau 1 – Questionnaire « Children-Fear Survey Schedule-Dental Subscale » (CFSS-DS) Une fois l'évaluation de l'anxiété effectuée, à l'aide de l'un ou l'autre de ces tests, le praticien sera plus à même d'adapter sa décision thérapeutique et de choisir entre les différentes approches comportementales et médicamenteuses qui sont à sa disposition. Les éléments les plus anxiogènes auront pour objectif d'être banalisés au fil des séances afin d'ouvrir la voie à un climat propice aux soins..
Scene 43 (1h 15m 21s)
[Audio] 30 3.2.2. L'hétéro-évaluation : Ici, l'anxiété n'est plus appréciée par le patient mais par une personne extérieure. Il existe différentes échelles. Cette méthode est particulièrement utilisée chez les enfants trop petits pour s'auto-évaluer ou pour répondre à un questionnaire . 3.2.2.1. L'échelle de VENHAM (22, 33) : Modifiée par Veerkamp, c'est la plus fréquemment utilisée. Elle a été validée par les études cliniques. C'est une échelle hautement fiable qui fournit une mesure indépendante de l'expérience et de l'investigateur. Score 0. Détendu, souriant, ouvert, capable de converser, meilleures conditions de travail possibles. Adopte le comportement voulu par le dentiste spontanément, ou dès qu'on le lui demande. Score 1. Mal à l'aise, préoccupé. Regard direct, mais expression faciale tendue. Observe furtivement l'environnement. S'appuie spontanément sur le dossier du fauteuil. Les mains restent baisséesou sont partiellement levées pour signaler l'inconfort. Pendant une manœuvre stressante, peut protester brièvement et rapidement pour montrer son inconfort. Le patient est disposé à - et capable de - dire ce qu'il ressent quand on le lui demande. Respiration parfois retenue. Capable de bien coopérer avec le dentiste. Score 2. Tendu. Le ton de la voix, les questions et les réponses traduisent l'anxiété. Multiplie les demandes d'informations. Mains crispées aux accoudoirs, peuvent se tendre et se lever, mais sans gêner le dentiste. S'appuie au dossier spontanément, mais la tête et le cou restent tendus. Accepte le main- dans-la-main. Regard direct. Pendant une manœuvre stressante, protestationsverbales, pleurs discrets possibles. Le patient interprète la situation avec une exactituderaisonnable et continue d'essayer de maîtriser son anxiété. Les protestations sont plus gênantes. Le patient obéit encore lorsqu'on lui demande de coopérer. La continuité thérapeutique est préservée. Score 3. Réticent à accepter la situation thérapeutique, a du mal à évaluer le danger. Soupire souvent. Protestations énergiques, pleurs possibles. S'appuie au dossier après plusieurs sollicitations, latête et le cu restent tendus. Légers mouvements d'évitement. Mains crispées, regard parfois fuyant. Accepte le main-dans-la-main. Hésite à utiliser les mains pour essayer de bloquer les gestes du dentiste. Gigote un peu. Proteste verbalement, larmoyant. Protestations sans commune mesure avec le danger ou exprimées bien avant le danger. Parvient à faire face à la situation, avec beaucoup de réticence. La séance se déroule avec difficultés..
Scene 44 (1h 19m 10s)
[Audio] 31 Tableau 2 – L'échelle de VENHAM (22, 33) Score 5. Totalement déconnecté de la réalité du danger. Inaccessible à la communication. Rejette le contact corporel. Serre les lèvres et les dents. Referme la bouche et serre les dents dès que possible. Agite violemment la tête. Pleure fort à grands cris, hurle, dit des injures, se débat, estagressif. Inaccessible à la communication verbale et visuelle. Quel que soit l'âge, présente des réactions primitives de fuite. Tente activement de s'échapper. Contention indispensable. Score 4. Très perturbé par l'anxiété et incapable d'évaluer la situation. Crispation importante, sourcils froncés, regard fuyant, les yeux peuvent être volontairement fermés. Pleurs véhéments sans rapport avec le traitement. Mouvements d'évitement brusques. Pose ses mains sur sa bouche ou sur le bras du dentiste mais finit par laisser faire. Serre les lèvres mais finit par garder la bouche ouverte. Soulève fréquemment sa tête du dossier. Rejette le contact corporel, mais peut encore accepter le main-dans- la-main. Importantes contorsions, nécessitant parfois une contention. Le patient peut être accessible à la communication verbale et finir, après beaucoupd'efforts et non sans réticence, à essayer de se maîtriser. La dissociation est partielle. La séance est régulièrement interrompue par les protestations..
Scene 45 (1h 21m 10s)
[Audio] 32 3.2.2.2. L'Echelle de FRANKL : L'échelle de Frankl est l'une des méthodes les plus simples d'hétéro-évaluation. Elle comprend quatre niveaux et permet d'évaluer l'enfant préscolaire dès la première consultation puis de suivre son évolution au fil des séances. Elle repose sur un score allant de 1 à 4 (12,34,56). Elle comprend quatre niveaux : - Au Niveau 1, le comportement est définitivement négatif : le patient refuse le traitement, crie avec force, et manifeste son opposition aux soins. - Au Niveau 2, le comportement est négatif : le patient est peu disposé à accepter les soins. Certains signes d'opposition existent mais ils ne sont pas forcément déclarés (l'air est maussade, renfrogné). - Au Niveau 3, le comportement est positif : le patient accepte le traitement avec réserve. Il est prudent mais suit les directives du praticien. - Au Niveau 4, le comportement est définitivement positif : il y a de bons rapports avec le praticien, le patient est intéressé par le traitement. Il rit souvent et semble apprécier la visite. 3.2.2.3. L'Echelle de HOUPT (52) : Cette échelle se base sur l'étude rétrospective du comportement du patient lors de la séance àl'aide d'enregistrements vidéos. Les items évalués concernent : - Les pleurs, - La coopération, - L'appréhension, l'attention, - L'évaluation de l'efficacité clinique de la séance. Score 1 : séance "blanche"- aucun traitement n'a pu être réalisé Score 2 : un traitement partiel a pu être réalisé mais il a dû être interrompu Score 3 : traitement presque achevé mais interrompu à la fin du traitement Score 4 : traitement achevé mais difficile Score 5 : mouvements très limités, en général au moment de l'anesthésieScore 6 : excellent - pas de pleurs ni de mouvements 3.2.2.3. L'Ohio State University Behavior Rating Scale (OSUBRS) (26) : C'est également une mesure rétrospective du comportement, basée sur l'enregistrement vidéo.Le comportement du patient est évalué en 4 niveaux: - Q : attitude de repos..
Scene 46 (1h 24m 32s)
[Audio] 33 - C : pleurs, sans agitation. - M : agitation, sans pleurs. - S : pleurs et agitation..
Scene 47 (1h 24m 53s)
[Audio] LA PRISE EN CHARGE PROPREMENT DIT. LA PRISE EN CHARGE PROPREMENT DIT.
Scene 48 (1h 25m 0s)
[Audio] 35 4. LA PRISE EN CHARGE PROPREMENT DIT 4.1. Avant la consultation : 4.1.1. L'arrivée au cabinet dentaire : - Accueil chaleureux : Assurez-vous que l'enfant et ses parents sont accueillis chaleureusement dès leur arrivée au cabinet dentaire. Un personnel amical et attentionné peut contribuer à créer un climat de confiance dès le début. - Communication rassurante : Le personnel d'accueil doit utiliser une communication rassurante et adaptée à l'âge de l'enfant. Expliquez brièvement ce à quoi s'attendre pendant la visite et répondez aux questions ou préoccupations des parents et de l'enfant. 4.1.2. La salle d'attente : Atmosphère accueillante : La salle d'attente doit être conçue de manière à être accueillante pour les enfants. Utilisez des couleurs vives, des jeux, des livres ou des jouets pour distraire et divertir les enfants en attendant leur tour. Zone de jeux : Prévoyez une zone de jeux où les enfants peuvent se détendre et s'amuser avant leur rendez-vous. Cela peut aider à détourner leur attention de l'anxiété potentielle liée à la visite chez le dentiste. 4.1.3. La salle de soin : Approche douce : Le dentiste et le personnel soignant doivent adopter une approche douce et empathique envers l'enfant. Prenez le temps d'expliquer les procédures de manière simple et rassurante, en utilisant des termes adaptés à l'âge de l'enfant. Techniques de distraction : Utilisez des techniques de distraction pour aider l'enfant à se détendre pendant les soins dentaires. Cela peut inclure la diffusion de musique apaisante, l'utilisation de jouets ou de tablettes avec des vidéos distrayantes, ou simplement engager une conversation amicale avec l'enfant. Contrôle du rythme : Permettez à l'enfant de contrôler le rythme des procédures dans la mesure du possible. Cela peut inclure des pauses pour se détendre ou des signaux pour indiquer s'il a besoin de faire une pause pendant le traitement..
Scene 49 (1h 27m 36s)
[Audio] 36 4.1.4. La conception du cabinet dentaire : Environnement ludique : Le cabinet dentaire peut être conçu de manière ludique avec des décorations colorées, des images amusantes, et des thèmes pour les enfants. Cela peut aider à créer une atmosphère moins intimidante pour l'enfant. Equipement adapté : Assurez-vous que l'équipement utilisé au cabinet dentaire est adapté aux enfants. Les instruments et les fauteuils dentaires conçus spécifiquement pour les enfants peuvent aider à rendre l'expérience plus confortable et moins effrayante. 4.2. La consultation 4.2.1. Première consultation : Établir une relation de confiance : Lors de la première consultation, le dentiste devrait se concentrer sur l'établissement d'une relation de confiance avec l'enfant. Prenez le temps de parler avec l'enfant et de l'écouter attentivement. Utilisez une approche douce et amicale pour établir une connexion positive dès le départ. Évaluation de l'anxiété : Évaluez le niveau d'anxiété de l'enfant en lui posant des questions ou en utilisant des échelles d'anxiété adaptées à son âge. Cela permet de mieux comprendre ses peurs spécifiques et d'adapter la prise en charge en conséquence. Développer un plan de traitement personnalisé : Après l'évaluation de l'anxiété, travaillez avec l'enfant et ses parents pour élaborer un plan de traitement personnalisé. Impliquez l'enfant dans la prise de décision en lui expliquant les différentes options et en respectant ses préférences dans la mesure du possible. Utiliser des techniques de désensibilisation : Pour les enfants ayant une odontophobie sévère, envisagez d'utiliser des techniques de désensibilisation progressives. Cela implique de présenter graduellement et de manière contrôlée les éléments du cabinet dentaire et des soins dentaires à l'enfant, afin qu'il puisse s'habituer progressivement à l'environnement et aux procédures..
Scene 50 (1h 30m 3s)
[Audio] 37 4.2.2. Organisation des rendez-vous : Préavis et rappels : Donnez aux parents un préavis suffisant avant les rendez-vous afin qu'ils puissent préparer mentalement leur enfant. Envoyez également des rappels de rendez-vous pour réduire l'anxiété liée à l'attente de la visite. Rendez-vous adaptés à l'enfant : Essayez de planifier les rendez-vous à des moments où l'enfant est le plus calme et réceptif. Les rendez-vous matinaux peuvent être préférables, car l'enfant est généralement plus reposé et coopératif à ce moment-là. Accompagnement parental : Encouragez les parents à accompagner leur enfant pendant les rendez-vous, surtout lorsqu'il s'agit de la première fois. La présence des parents peut offrir un soutien émotionnel et rassurer l'enfant. Utiliser des approches ludiques : Utilisez des approches ludiques pour distraire l'enfant pendant les soins dentaires. Cela peut inclure l'utilisation de jouets, de jeux ou de récompenses pour renforcer les comportements coopératifs. Récompenses et encouragements : Encouragez et récompensez les comportements positifs de l'enfant tout au long de la visite. Les encouragements verbaux, les autocollants ou les petits cadeaux peuvent aider à renforcer son estime de soi et à favoriser une attitude positive envers les soins dentaires..