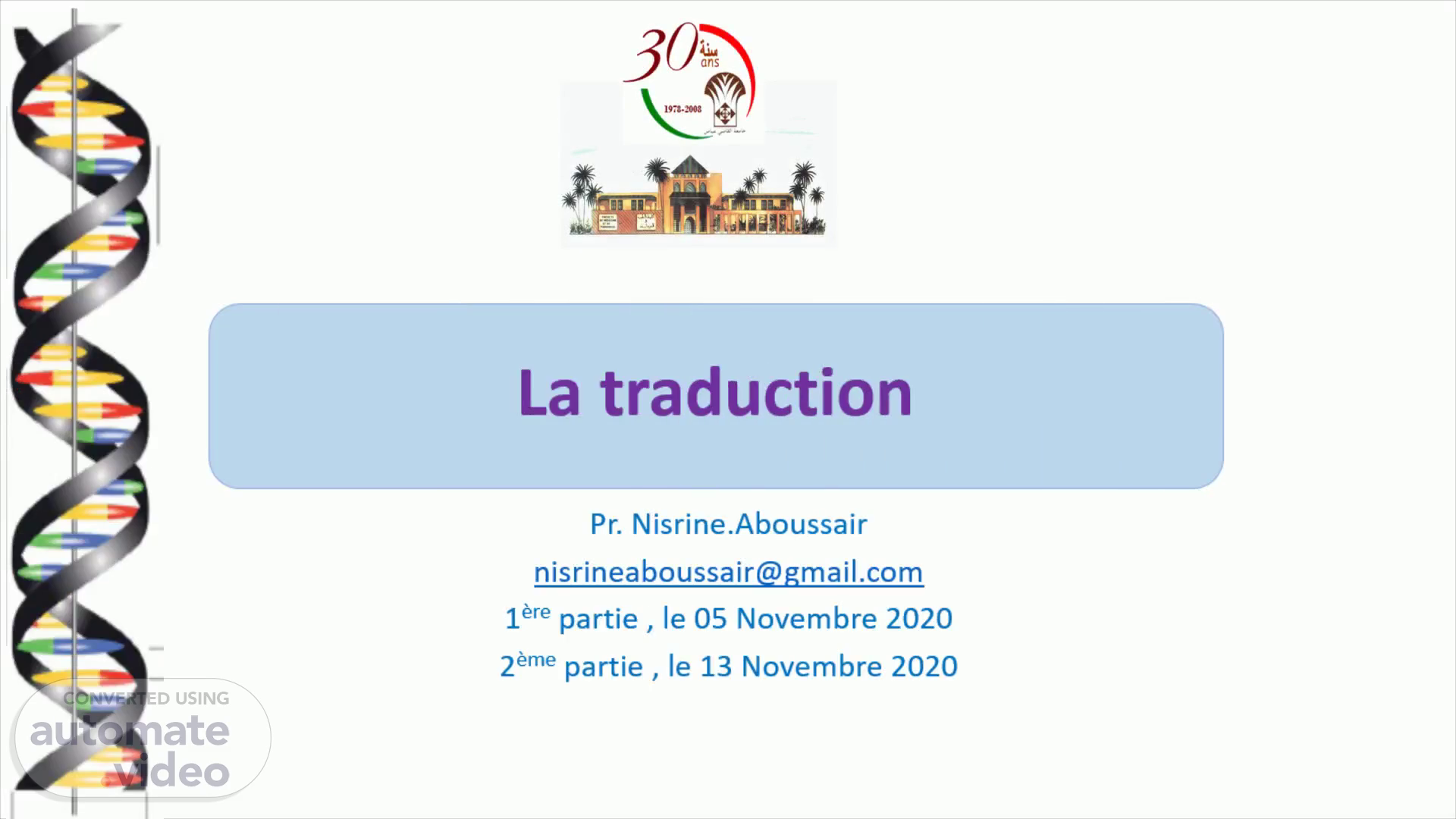Scene 1 (0s)
La traduction. Pr. Nisrine.Aboussair nisrineaboussair@gmail.com 1 ère partie , le 05 Novembre 2020 2 ème partie , le 13 Novembre 2020.
Scene 2 (22s)
2. Donner la définition de la traduction. Citer le principe et les caractéristiques du code génétique. Citer les éléments nécessaires à la traduction. Connaître les mécanismes et les différentes étapes de la traduction. Décrire les mécanismes de régulation de la traduction chez les eucaryotes ..
Scene 3 (58s)
3. I. Introduction II. Le code génétique III. Les éléments nécessaires à la traduction. IV. Les mécanismes de la traduction. V. Modifications post-traductionnelles. VI. La régulation de la traduction. VII. Conclusion.
Scene 4 (1m 32s)
4. La traduction est le phénomène au cours duquel une protéine est synthétisée : L’information génétique stockée dans l’ADN génomique puis transcrite en ARNm sera traduite en protéine c’est-à-dire décodée par le ribosome. L’étape de traduction permet de passer d’une structure nucléotidique à une structure peptidique . Elle a lieu au niveau du cytoplasme . C’est le plus complexe des mécanismes de biosynthèse : plusieurs molécules doivent coopérer afin de synthétiser un polypeptide..
Scene 5 (2m 52s)
5. I. INTRODUCTION. Traduction Transcription Traduction.
Scene 6 (3m 57s)
6. La biosynthèse des protéines repose sur l’utilisation d’un code qui fait correspondre les 4 lettres (A,G,C,U) de l’ARNm aux 20 acides aminés. Le code génétique est constitué de triplets de nucléotides successifs lus sur l’ARNm pour coder chaque AA. Ces triplets sont appelés codons . Le code génétique comporte 64 codons ..
Scene 7 (5m 2s)
7. Codon d’initiation. 20 Acides Aminé. 64 Codons.
Scene 8 (7m 31s)
8. Base nucléotidique Première Deuxième Troisième Code génétique des différents acides aminés.
Scene 9 (8m 33s)
9. Caractéristiques du code génétique. 1 . Le code génétique est sans ponctuation , ni chevauchement entre triplets : 1 base fait partie d’un et un seul triplet sans interruption. La séquence en acides aminés d’une protéine est donc définie par une séquence linéaire de codons (triplets contigus). Le premier codon de la séquence établit et fixe un cadre de lecture dans lequel un nouveau codon débute tous les 3 résidus. Un brin d’ADN a 3 cadres de lecture ..
Scene 10 (10m 1s)
10. Caractéristiques du code génétique. 3 cadres de lecture.
Scene 11 (11m 37s)
11. Cadre de lecture ouvert (ORF). Caractéristiques du code génétique.
Scene 12 (13m 12s)
12. Décalage du cadre de lecture. Caractéristiques du code génétique.
Scene 13 (14m 47s)
13. 2 . Le code génétique est dégénéré ( redondant ): Plusieurs codons pour un même acide aminé : Un acide aminé peut être codé par plusieurs codons différents (Ex: Arginine , leucine , sérine). La dégénérescence porte sur la 3 ème base = plusieurs codons pour un même acide aminé , ne différant que par la 3 ème base (base flottante). La dégénérescence constitue un système de protection vis à vis des mutations qui peuvent se produire : un changement de la 3 ème base se révélera le plus souvent sans conséquence pour le codon muté..
Scene 14 (15m 27s)
14. Caractéristiques du code génétique. Codon d’initiation Le code est dégénéré.
Scene 15 (16m 18s)
15. 2 . Le code génétique est dégénéré ( redondant ): Plusieurs codons pour un même acide aminé : Un acide aminé peut être codé par plusieurs codons différents (Ex: Arginine , leucine , sérine). La dégénérescence porte sur la 3 ème base = plusieurs codons pour un même acide aminé , ne différant que par la 3 ème base (base flottante). La dégénérescence constitue un système de protection vis à vis des mutations qui peuvent se produire : un changement de la 3 ème base se révélera le plus souvent sans conséquence pour le codon muté..
Scene 16 (17m 13s)
16. Caractéristiques du code génétique. 3 . Le code génétique est presque universel : Il est le même chez tous les organismes , exception faite de l’ADN mitochondrial pour lequel quelques codons diffèrent. Un seul codon AUG signale le commencement d’une chaîne polypeptidique. C’est le codon d’initiation qui code aussi pour la méthionine en position interne au sein d’une chaîne polypeptidique. Trois codons ne codent pour aucun acide aminé ( UAA , UAG , UGA ) : Ce sont les codons de terminaison ou codons stop ou non sens . 4 . Le code génétique est non ambigu : à un codon donné correspond un seul acide aminé..
Scene 17 (19m 36s)
17. Codon d’initiation. Le code est non ambigu. Caractéristiques du code génétique.
Scene 18 (20m 18s)
18. Le ribosome Les acides aminés L’ARNm L’ARN de transfert ( ARNt ) Des enzymes.
Scene 19 (21m 20s)
19. C’est le lieu de la traduction (cytoplasme). Il est constitué de 2 sous unités : une grande et une petite (60 S et 40 S chez les eucaryotes). Chaque unité est formée d’un mélange d’ARN ribosomique (ARNr) et de protéines. Les sous unités sont synthétisées dans le nucléole..
Scene 20 (22m 26s)
20. Le ribosome. Ribosome total Petite sous unité Grande sous unité Eucaryotes 80 S 40 S (ARNr 18 S + 33 protéines). 60 S (ARNr 28 S , ARNr 5,8 S , ARNr 5 S + 45 protéines). Procaryotes 70 S 30 S (ARNr 16 S + 21 protéines). 50 S (ARNr 25 S , ARNr 5 S + 34 protéines)..
Scene 21 (24m 10s)
21. 50S Ribosome (23S+5S+34 Proteins) a mRNA AAAUCG 30S Ribosome (16% 21 Proteins) Codon Codon a as aa6 aa,+ tRNA arriving Site of blndlng 3' Movement Of the ribosome.
Scene 22 (24m 47s)
22. Le ribosome. La synthèse de la plupart de protéines ne dure qu’une 20 aine de secondes à quelques minutes. Nécessité de plusieurs initiations de la traduction sur un même ARNm..
Scene 23 (26m 29s)
23. Le ribosome. L’assemblage des 2 sous unités du ribosome permet la formation de 3 sites sur lesquels vont venir se positionner les molécules de l’ ARNt chargé. Site A: site d’acide aminé (AA) où viendra se loger l’ ARNt porteur de l’AA. Site P: site peptidique où se place l’ ARNt portant la chaîne peptidique en cours de synthèse. Site E: site de sortie..
Scene 24 (27m 35s)
24. L’ARNm. Grande sous unité Petite sous unité ARNm ARNt initiateur.
Scene 25 (28m 15s)
25. Grande sous unité Petite sous unité ARNm ARNt initiateur LARNt est considéré comme un adaptateur entre l’ARNm et l’acide aminé. L’ARNt : ARN de transfert.
Scene 26 (28m 40s)
26. L’ARNt : ARN de transfert. L’ ARNt a une structure en feuille de trèfle (boucles + tiges). Les boucles contiennent des bases modifiées ( inosine = dérivé de l’Adénine) ne permettant pas l’appariement. L’ ARNt a 2 sites importants : Anticodon : succession de 3 bases situées sur une boucle de l’ ARNt et complémentaires d’un codon (site de liaison à l’ARNm). Site de fixation de l’AA : L’ ARNt est lié à l’AA par son extrémité 3’ (qui se termine par CCA)..
Scene 27 (30m 36s)
27. L’ARNt : ARN de transfert. Site de fixation de l’AA Anticodon.
Scene 28 (30m 45s)
28. Les AA en réserve dans le cytoplasme arrivent au niveau du ribosome attachés à leur ARNt spécifique qui les transporte sous forme activée amino-acyl ARNt. L’activation de l’AA est réalisée par une amino-acyl ARNt synthétase spécifique de l’AA et de son ARNt correspondant. Cette étape est appelée charge de l’AA sur l’ARNt..
Scene 29 (31m 37s)
29. Les acides aminés (AA). ATP + Acide Aminé. Acide aminoacyl-adénylique.
Scene 30 (32m 28s)
30. Brin non codant ADN C T A Brin codant Codon Anticodon.
Scene 31 (34m 20s)
31. 31. PLAN. I. Introduction II. Le code génétique III. Les éléments nécessaires à la traduction. IV. Les mécanismes de la traduction. V. Modifications post-traductionnelles. VI. La régulation de la traduction. VII. Conclusion.
Scene 32 (34m 34s)
32. Terminaison Élongation Initiation. IV. Les mécanismes de la traduction.
Scene 33 (35m 29s)
33. 1. Initiation. Elle fait intervenir : Le segment 5’ de l’ARNm La coiffe méthylée La petite sous unité du ribosome Une série de facteurs protéiques d’initiation (EIF= eucaryotic initiation factor) Mg++ GTP.
Scene 34 (36m 44s)
34. 1. Initiation. Un facteur d’initiation se fixe sur la coiffe de l’ARNm facilitant ainsi la reconnaissance du premier codon AUG qui sera initiateur. La petite sous unité se lie aux facteurs d’initiation et le complexe ainsi formé se lie à son tour à l’ARNm. Un autre facteur facilite la liaison entre le méthionyl ARNt initiateur et la petite sous unité liée à l’ARNm. Le méthionyl ARNt initiateur se place d’emblée au site P face au codon AUG de l’ARNm ..
Scene 35 (38m 44s)
35. 1. Initiation. Grande sous unité Petite sous unité ARNm ARNt initiateur.
Scene 36 (39m 13s)
36. Amino end of mRNA Ribosome ready for next aminoacyl tRNA can GDP Translocation Activitk recognition transfé 2 GDP bond formation.
Scene 37 (42m 32s)
37. "dion charged tRNA POW bond form aton of 'RNA Addition fiNA.
Scene 38 (43m 8s)
38. Release factor 5' Stop (UAG, UAA, or UGA) plypeptide 5'.
Scene 39 (44m 6s)
39. 3. Terminaison. Facteur de largage (RF) Polypeptide Libre.
Scene 40 (45m 32s)
40. La plupart des antibiotiques utilisés pour traiter les infections bactériennes sont des inhibiteurs de la traduction . Ces antibiotiques sont associés à l’inhibition d’une étape précise de la traduction par exemple: Blocage de la fixation d’un ARNt porteur d’un acide aminé sur le site A du ribosome (Tétracycline). Blocage de l’action de la peptidyl transférase (Chloramphénicol). Blocage de la réaction de translocation du ribosome (Erythromycine)..
Scene 41 (47m 17s)
41. PLAN. 41. I . Introduction II. Le code génétique III. Les éléments nécessaires à la traduction. IV. Les mécanismes de la traduction. V. Modifications post-traductionnelles. VI. La régulation de la traduction. VII. Conclusion.
Scene 42 (47m 39s)
42. Après la traduction , différents types de modifications peuvent se produire sur les protéines. Ces modifications jouent un rôle important dans la fonction de la protéine +++ Ces modifications peuvent être permanentes ou réversibles +++ Clivage Formation de ponts disulfures Hydroxylation Addition de lipides Addition de sucres (glycosylation) Association à des ligants (vitamines et métaux) Repliement protéique en une conformation tridimensionnelle.
Scene 43 (48m 51s)
43. 1.Clivage. Raccourcissement de la chaîne peptidique : le plus souvent la méthionine initiale d’une protéine est éliminée . Clivage d’un précurseur : De nombreuses protéines sécrétées sont synthétisées sous la forme d’un précurseur plus long qui va subir un ou plusieurs clivages protéolytiques avant de donner la protéine mature physiologiquement active. Adressage des protéines : Certaines protéines doivent être dirigées en un endroit précis de la cellule pour y remplir leur fonction. A cette fin elles possèdent à leur extrémité N-terminale, une séquence contenant au maximum 30 acides aminés , la séquence signal qui détermine la destination finale de la protéine dans la cellule. Ex: les protéines destinées à la sécrétion contiennent une quinzaine d’AA hydrophobes ,précédés d’AA positivement chargés en N terminal de la séquence signal. Une fois les polypeptides sont dans le réticulum endoplasmique , la séquence signal est éliminée enzymatiquement..
Scene 44 (51m 3s)
44. 4 Gine de la calcitonine THYROIDE TISSU NEURAL Thyroide ARNm Peptide Peptide 123 Cap Calcitoninc 2' 13 traduetion Clivge Cap post-traducticnnel pA2 5bl Ti::u neural PolyA CGRP.
Scene 45 (53m 16s)
45. Après la traduction , différents types de modofications peuvent se produire sur les protéines Ces modifications jouent un rôle important dans la fonction de la protéine +++ Ces modifications peuvent être permanentes ou réversibles +++ Clivage Formation de ponts disulfures Hydroxylation (addition d’un groupement OH) Addition de lipides Addition de sucres (glycosylation) Association à des ligants (vitamines et métaux) Repliement protéique en une conformation tridimensionnelle.
Scene 46 (53m 49s)
46. 2CollPDB. Collagène (hydroxylation de la proline).
Scene 47 (54m 23s)
47. Après la traduction , différents types de modifications peuvent se produire sur les protéines Ces modifications jouent un rôle important dans la fonction de la protéine +++ Ces modifications peuvent être permanentes ou réversibles +++ Clivage Formation de ponts disulfures Hydroxylation (addition d’un groupement OH) Addition de lipides Addition de sucres (glycosylation) Association à des ligants (vitamines et métaux) Repliement protéique en une conformation tridimensionnelle.
Scene 48 (55m 45s)
48. Voir une hélice en 3D avec Chime. Voir les feuillets beta en 3D avec Chime.
Scene 49 (57m 32s)
chaine ß chaine a chaine B chaine u Héme. Structure tertiaire de la myoglobine Structure quaternaire de l’hémoglobine.
Scene 50 (58m 30s)
50. abstract. La régulation de la traduction. Utilisation d’un codon AUG en amont du site d’initiation de la traduction. Traduction contrôlée par un IRES. Contrôle négatif par des protéines en 5’ et 3’UTR. Régulation par phosphorylation d’un facteur d’initiation..